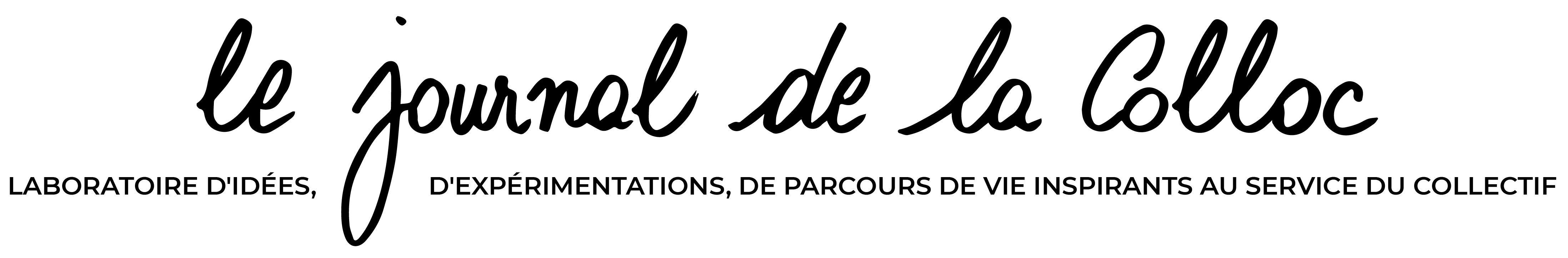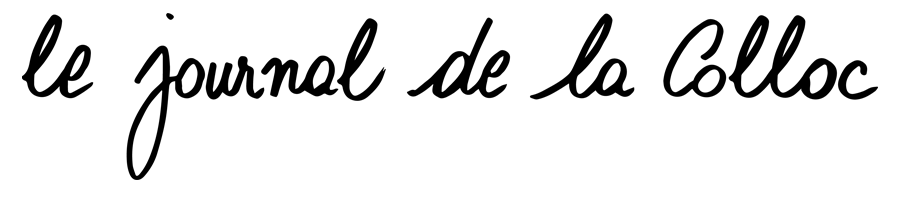Savez-vous qu’il suffit d’une bise pour déstabiliser un Anglais (cf le pamphlet inspiré de Paul Taylor ) ? Ou bien qu’il faut s’immobiliser à l’écoute de l’hymne royal dans les rues de Bangkok ? Bienvenue dans le monde aussi merveilleux que mystérieux de l’interculturalité. Pas de panique, Cécile Niort Currier, passionnée de relations interculturelles et facilitatrice de processus collaboratifs, nous donne quelques conseils pour naviguer en eaux diplomatiques.
Coconut : L’interculturalité, c’est quoi ?
Cécile Niort Currier : « Au sens étymologique du terme, la culture est un système de significations qui est propre à un groupe, fondé sur des valeurs. Ces valeurs vont impliquer un comportement et des pratiques qui varient d’un groupe à l’autre. En un mot, l’interculturalité, c’est vivre avec la diversité. Ce n’est pas simplement une question de langue ou de couleur de peau. L’interculturalité se vit dans la hiérarchie, dans les rapports professionnels, dans le voyage également, et bien sûr dans l’expatriation. En prenant conscience de ce qui se joue dans ces relations interculturelles, on peut commencer à comprendre les origines des différences entre cultures et ainsi améliorer la coopération. C’est le cœur de mon métier de facilitatrice. J’accompagne les entreprises et associations qui veulent travailler sur un mode coopératif. Je facilite l’émergence d’idées dans un collectif, puis j’aide à la mettre en oeuvre ensemble grâce à un plan d’actions. »
C. : Que se passe-t-il si l’on n’appréhende pas correctement cette interculturalité ?
C.N.C. : « En socio-anthropologie, on détermine deux grands écueils qui peuvent faire échouer la rencontre interculturelle. Soit, on appréhende l’autre comme entièrement différent, ce qui peut mener à la domination et au racisme ; soit on nie les différences qui nous séparent et on efface les caractéristiques de l’un ou de l’autre, c’est l’assimilation.
Pour trouver un juste milieu, on a tendance à commencer par se renseigner sur l’autre. C’est tout à fait humain, mais le danger c’est d’appliquer à l’autre des stéréotypes. Pour comprendre son système culturel, on va le simplifier et on risque de glisser vers le préjugé. Il faut savoir nuancer chaque information. Imaginez une situation dans laquelle deux chefs d’entreprise, l’un japonais, l’autre français, se rencontrent. Chacun s’est préparé. Le Français sait que les Japonais ne se serrent pas la main. Le Japonais s’attend au contraire à ce que le Français lui tende la main. En résulte un malentendu, dans lequel chacun est finalement enfermé dans son stéréotype. C’est pour cela que l’interculturalité est complexe. Evidemment, lorsque l’on n’est pas préparé, on peut commettre des impairs. Mais, inversement, une mauvaise préparation peut nous faire passer à côté de la rencontre. »
C. : Pas simple effectivement. Alors, que fait-on pour éviter ça ?
C.N.C. : « Mon conseil, pour éviter ces malentendus relationnels, c’est de se centrer sur soi. Ma première compétence interculturelle sera de comprendre où j’en suis de mes représentations, à l’argent, aux autres, au travail. En prenant d’abord conscience de mes valeurs, j’intègre qu’elles n’appartiennent qu’à moi et que, forcément, l’autre possède des prismes similaires. Se découvrir soi avec humilité et faire ce travail permet de se projeter sur l’autre et de casser l’ethnocentrisme. Il faut prendre aussi conscience des étiquettes qui nous sont accolées. Une femme française sera par exemple vue dans certains pays comme sophistiquée, passionnée de mode et libérée. La rencontre avec l’altérité commence par soi ; c’est en rencontrant l’autre que j’apprends à me connaître. C’est la beauté du voyage.
Toute la difficulté de l’interculturalité est de faire chemin vers l’autre, tout en gardant sa propre personnalité. Il existe un exemple très célèbre de réussite interculturelle professionnelle. C’est la collaboration entre Nissan et Renault en 1999. Avant de construire leur alliance, chaque entreprise a travaillé sur ses valeurs, puis a déterminé ses priorités propres. Les deux compagnies ont pu ensuite équilibrer leurs volontés, sans qu’il y ait assimilation de la part de l’un ou l’autre.
Il faut penser au-delà des différences culturelles. En face de moi, j’ai un être humain avec une personnalité, ce n’est donc pas en lui appliquant un stéréotype culturel que je vais pouvoir rentrer en contact avec lui. »
C. : Il existe différentes formations interculturelles. Sont-elles utiles ?
C.N.C. : « Tout dépend de leur contenu. Mais d’une manière générale, je dirais qu’elles sont intéressantes en groupe, en entreprise par exemple. Dans ce contexte, il y a une identité forte, qu’il faudra analyser et comprendre. En revanche, en tant qu’individu, il est plus facile de faire le travail soi-même, en se « décentrant », c’est-à-dire en repérant ses propres valeurs pour mieux s’en écarter. Il peut aussi être intéressant de se renseigner sur des sites d’expatriés, comme Retour en France ou Femme Expat qui permettent d’entrer en contact avec des gens sur place, qui pourront vous guider.
Pendant dix ans, j’ai accompagné des étudiants en travail social qui partaient à l’étranger pour des missions humanitaires. Pour compenser les chocs culturels, nous mettions en place une préparation en amont et un suivi sur place. Il s’agissait de comprendre les attentes de chacun et d’identifier les représentations. Qui suis-je ? Qu’est-ce qui me pousse à faire ce travail ? Qu’est-ce que je possède ? C’est bien plus efficace que d’appliquer des stéréotypes. L’exil déstabilise. Je me souviens par exemple d’une jeune femme qui avait été envoyée au Mali et ne s’y sentait pas intégrée. Elle rencontrait des problèmes de langue et d’attitude vis-à-vis de son genre. Je l’ai accompagnée dans cette remise en question. Pourquoi les Maliens s’adapteraient-ils à toi, Européenne venue dans leur pays ? Elle a réussi à redresser la situation en se décentrant, en acceptant que le blocage venait aussi de ses représentations. Elle avait un idéal d’intégration, une vision de comment ils devaient la considérer, et c’est cet idéal qu’elle a su déconstruire et dépasser. »
Après plusieurs années passées à travailler dans des quartiers d’habitat social, composés de populations très métissées, Cécile Niort Currier reprend des études et obtient un DEA en socio-anthropologie, couplé d’un Magistère de relations interculturelles (Paris V). Forte de ces nouvelles compétences, qu’elle associe à une grande expérience du voyage et de l’interculturalité (elle est mariée à un Américain et vit entre une maison à Lorient et un bateau de pêche en Alaska), Cécile choisit de devenir facilitatrice de processus collaboratifs (voir son profil). Un métier au nom complexe, qu’elle explique tout simplement : « dans un groupe, chaque individu est porteur de connaissances, parfois les moyens ne sont pas mis en œuvre pour que tout le monde s’exprime. On ne s’écoute pas, on n’ose pas parler, je fais en sorte par des exercices et outils, que chacun puisse exprimer sa vision, son intelligence de la situation, afin de construire ensemble et de transformer nos façons de travailler. »
Pour en savoir plus, lisez également l’article d’Anna Camargo, paru dans Harvard Business Review le 11/01/2018.