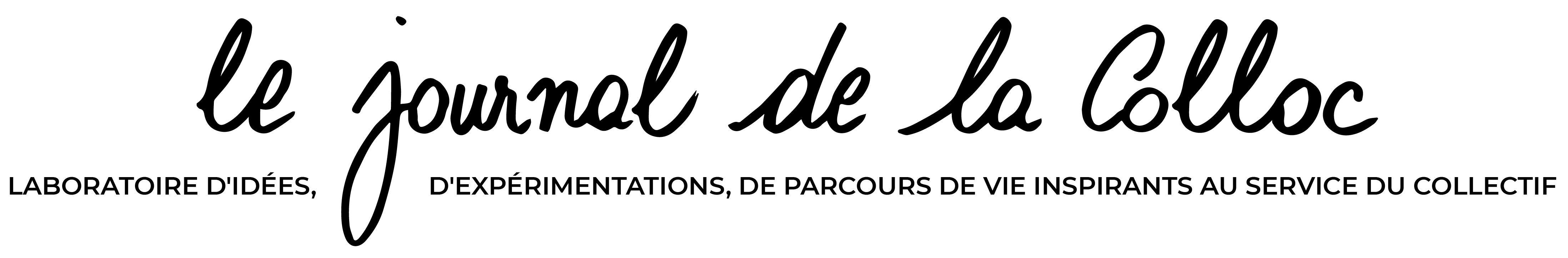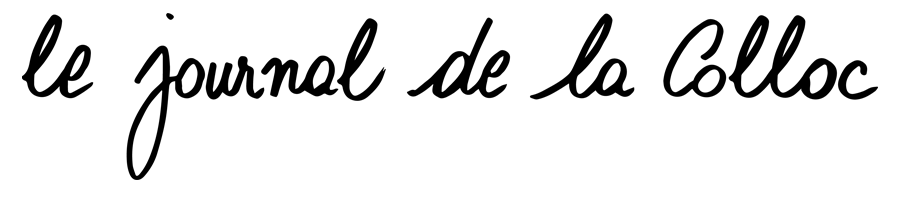Cela commence généralement par un constat. Je m’ennuie. Je n’aime pas ce que je fais. Je bosse pour Satan. Je ne sers à rien. Puis, vient le déclic. Et si je changeais tout ça en insufflant du sens à mon activité ? Et si je répondais à mon social calling ? Décryptage d’un phénomène en pleine expansion.
En préambule, IPSOS (2015) nous file un bon coup de déprime : 50% des Français ont le sentiment de passer à côté de leur vie et 39% rêvent de tout plaquer. Pourquoi ? Parce qu’ils ont l’impression que leur travail n’a pas de sens. Et c’est là que le social calling intervient. La journaliste Emilie Vidaud, auteure d’une grande enquête sur ce phénomène (1), explique ce mécanisme, qui permet de passer du désenchantement à l’action – et à la satisfaction. Le « déclic pour agir » ou social calling en anglais (et en plus stylé) provoque une décision capitale : notre moteur principal n’est plus de simplement gagner de l’argent, mais de gagner de l’argent en ayant un travail qui a du sens pour nous et pour les autres. En d’autres termes, les adeptes du social calling choisissent de « faire converger l’intérêt général et la volonté de faire du profit, tout en ayant un impact positif sur la société et l’environnement »(2). En « produisant » du sens, en se rendant utile, en jouant un rôle positif dans la société et en pensant collectif. Ces individus veulent contribuer à changer le monde. Et quel est le levier le plus puissant pour y arriver ? Je vous le donne en mille : le travail.
Cette quête du sens au travail n’est pas nouvelle, loin de là. Elle existe depuis que le concept de travail existe. En revanche, ce qui est nouveau, c’est sa généralisation.
L’influence du digital
Entre autres facteurs, le digital joue un rôle prépondérant dans cette démocratisation de la quête de sens. Depuis trente ans, internet nous donne accès à une source de connaissance sans précédent et donc à une grande liberté de choix. Si on cherche de l’info, on trouve. Tout devient possible. C’est cette puissance digitale qui provoque une prise de conscience, terreau du social calling. Le numérique façonne des esprits très autonomes, capables de choisir eux-mêmes leurs références. Si le social calling touche tous les âges, il résonne ainsi particulièrement dans la génération des Millenials, qui a grandi en même temps qu’internet. On choisit donc de prendre les choses en main, plutôt que d’attendre que quelqu’un – les puissances publiques par exemple – le fasse à notre place.
Source du phénomène, le digital est aussi part de la solution. Parce que les problématiques sont globales – respecter l’humain, préserver l’environnement, promouvoir l’accès à la connaissance – leur réponse doit être massifiée. Grâce au digital, cela devient possible. Plateformes collaboratives, micro influence, crowdfunding, applis mobiles, le digital devient la base de cette démarche sociale. Openclassrooms (fondé par Matthieu Nebra en 1999, alors collégien de 13 ans !), par exemple, propose une plateforme numérique qui permet d’accéder à des cours gratuits en ligne. Sigfox se place lui en opérateur de télécommunications à faible consommation énergétique. Les entrepreneurs « tech », startupers et autres passionnés de social tech (technologie utile) apparaissent ainsi les plus nombreux à répondre à cet appel du social calling. Dans son enquête, Emilie Vidaud assure pourtant qu’il n’y a pas de spécificité de genre ou de classe sociale. Le déclic pour agir peut se traduire sous la forme de l’entreprenariat, chez ceux donc l’activité le permet, mais aussi sous la forme d’un engagement associatif ou politique.
Le concept du social business
Le social calling définit progressivement un modèle nouveau d’entreprise : le social business ou entreprise sociale (transfuge de l’économie sociale et solidaire). Si la France s’éveille aujourd’hui à ce mouvement, les pays anglo-saxons ont saisi le coche depuis déjà plusieurs années. Les Etats-Unis comme le Royaume-Uni, chantres du capitalisme triomphant, ont bien compris que ce besoin de sens et d’engagement stimule l’économie. Depuis les années 2000, les pays du Commonwealth tentent d’ouvrir une nouvelle voie économique. Ainsi, des modèles d’associations à but lucratif ou d’entreprises d’intérêt général, les public benefit corporations, sont créés.
Dans le même temps, le Professeur Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix en 2006 et inventeur du concept de micro-crédit, formule la théorie du social business, l’entreprise sociale (3). Les social business sont voués à la résolution d’un problème social (éducation, santé, accès aux technologies, environnement), tout en étant respectueux des hommes et de l’environnement. Les profits sont réinvestis dans l’activité de l’entreprise et aucun dividende n’est versé aux actionnaires. On n’adopte pas la structure associative, qui dépend de financements publics ou privés, mais celle de l’entreprenariat social – l’entreprise est autonome financièrement. Si les investisseurs choisissent de s’impliquer dans une structure viable économiquement et à vocation sociale, ils doivent accepter qu’aucun dividende ne leur sera reversé. Etre utile en gagnant de l’argent, dans la joie et la satisfaction. Un but ultime, que les fondateurs de Veja, par exemple, tentent d’atteindre. Ces créateurs de baskets imaginent un produit qui, à chaque étape de sa fabrication et de sa distribution, a un impact positif sur les hommes et l’environnement. Toujours en réflexion, Veja explique aussi les limites actuelles de sa démarche, comme le fait que ces baskets ne sont pour l’instant pas recyclables, et cherche continuellement de nouvelles solutions.
Impulser une démarche sociale dans l’entreprise classique
Insuffler un souffle social à l’entreprise classique est une autre manière d’agir. Lorsqu’elles constatent que le consommateur devient « consomacteur », en s’investissant dans sa consommation et en influant sur les tendances, certaines entreprises réalisent qu’elles doivent retravailler leurs valeurs sociales. Le social calling se répand comme une traînée de poudre et voilà que Danone ou la Camif créent des fondations au service de l’homme et de l’environnement. Si la démarche peut paraître hypocrite – je redore mon blason tout en perpétuant de mauvaises pratiques – elle a le mérite d’exister. D’autres entreprises font le choix de créer un environnement plus humain au sein de leur équipe, encourageant les projets collaboratifs, soutenant « l’intraprenariat ». Les collaborateurs deviennent « collaboracteurs ».
En France, le projet de loi Pacte, actuellement en discussion au Parlement, a pour mission, entre autres, de changer l’objet social de l’entreprise (inchangé depuis 1804 !). L’objet de l’entreprise intègrerait les valeurs de l’économie sociale et solidaire, une vocation sociale et environnementale, en plus de la réussite financière. Ce social calling généralisé oblige donc chacun à repenser un capitalisme moins dévastateur et plus inclusif. On imagine alors des usines appliquant des conditions de travail humaines, mais un management plus respectueux (4). Seuls 9% des salariés se disent motivés au travail. En inventant une entreprise plus sociale, en donnant du sens au travail de chacun, on impulse un souffle nouveau, qui replace au cœur des préoccupations de l’entreprise des valeurs d’innovation et d’égalité. Pour un monde du travail toujours plus enrichissant et épanouissant.
________________
Sources :